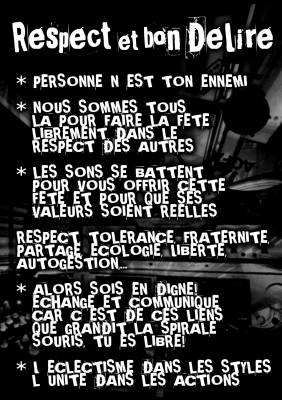ça rest un monde meilleur ...le reve de marx l'égalité des hommes tou ça
mai il y a tro de paradoxe la dedan...si t'a la patience de lire une critique cinématografik,jett un oeil la dessus
Critique du film Fight Club,"Donnons du spectacle au spectateur en lui faisant croire que c'est un rebelle"
La critique de ce qu'on appelle un peu rapidement la société de consommation avait déjà été faite par le cinéaste Michelangelo Antonioni avec Zabriskie point (1970) et surtout par Michael Haneke dans Le Septième continent (1991). David Fincher juste avant l'an 2000 remettait cela avec Fight Club (1999) dans l'un des films les plus surfaits de la dernière décennie. Les rebelles de synthèse n'ont pas manqué de relever que puisque les "média du système" n'ont pas aimé Fight Club, c'est que Fight Club était un film forcément bon. Il est étrange de tomber dans une telle souricière car Fight Club est le pur produit dudit système, (tout d'abord d'Hollywood ce qui est fortement risible, même en se prétendant secrètement « rebelle » à l'intérieur de l'institution) mais encore d'une société et du pouvoir qui parlent de nos jours sans arrêt le langage de la révolte et de la rébellion, histoire de s'amadouer subtilement la jeunesse et les cyber-jeunes. Car si ce film était aussi dérangeant qu'on le prétend, il serait proprement « irrécupérable ». C'est donc l'occasion d'aborder une tendance postmoderne qui, en parallèle avec un film comme Fight Club, renforce le système comme on dit tout en faisant croire qu'elle en est la dénonciation ultime. Piège qui a fait que le film est devenu « culte », mot qui en lui-même en dit long.
Le narrateur (Edward Norton) est un cadre employé dans une firme de construction automobile. Voyageant d'aéroport en aéroport, son travail consiste à répertorier les éventuelles erreurs de fabrication pouvant provoquer un accident. Son existence est morne et il s'est pris de passion pour son appartement meublé Ikéa dont il dévore les catalogues. Premier constat : la société d'abondance ne procure pas le bonheur. Le narrateur vit seul, travaille seul, dort seul, mange dans des plateaux-repas. Misère humaine, morale et sexuelle. Il veut s'évader de son monotone quotidien (tout quotidien n'est pas synonyme d'ennui) au point de souhaiter qu'il lui arrive un accident d'avion. Pour se soulager de ses insomnies, il fréquente des associations et rencontre des gens aussi désorientés que lui et dont leurs maladies empêchent de s'intégrer à la société. Là, il fait la connaissance de Marla (Helena Bonham Carter) une autre "touriste" se nourrissant de la souffrance des autres. Et voilà qu'un jour, le narrateur fait la connaissance dans un avion de Tyler Durden (Brad Pitt), un vendeur de savon. Les deux hommes deviennent "amis". Ensemble, ils décident de créer un club de combat clandestin (le Fight Club). Le narrateur se laisse entraîner par les théories philosophiques de Tyler : « La douleur est la vérité, l'unique vérité. » Et ce qui commence comme une bagarre entre deux amis pour " sentir la douleur " aboutit à une organisation terroriste visant la destruction de la société de consommation.
Comme on le sait, le film est commenté tout du long (avec une énormité temporelle, le récit du narrateur durant deux heures alors que les immeubles vont exploser dans quelques minutes), et au début, on nous décrit en long et en large les méfaits et les frustrations qu'engendre la société de consommation. On peut critiquer cette bavarde voix-off qui désigne du doigt et souligne sans arrêt au stabilo la problématique du film. Face à cette insistante démonstration, on aurait préféré que le film nous fasse comprendre tous les enjeux d'une façon suggestive. Passons. Il s'agit ici d'appâter le spectateur. Fight Club veut bien traiter bien de quelque chose, tente de nous ancrer dans la réalité, parle du réel à des spectateurs qui voient tout de suite à quoi il est fait allusion et peuvent ainsi se référer à leur propre amère expérience et aux sentiments qu'ils éprouvent dans la réalité par rapport à un tel sujet. Je passe sur le coté clinquant et brutal de la mise en scène, l'esthétique racoleuse de la photo, des mouvements d'appareil. Fincher en a déjà abusé avec Seven. Sa "mise en scène" est très à l'estomac, très formatée dans sa facture. Il donne plus la sensation de vouloir créer des effets et du rythme vaille que vaille que de poser les choses et de les traiter rigoureusement. Par ailleurs, David Fincher est aussi un réalisateur de publicité et de clips de chanteurs comme Madonna ou George Michael . Ce n'est guère étonnant tellement le début de Fight Club est dans ce créneau clip MTV avec moult effets, musique jeune et une caméra filant à cent à l'heure. Si on compare Fight Club avec des films comme ceux de Michael Haneke (Benny's vidéo, 71 fragments d'une chronologie du hasard, Funny Games...) et à son premier film Le septième continent qui montre une famille qui va se suicider, on ne ressort pas de ces derniers avec l'envie d'aller dans un supermarché pour consommer. Aucune « jouissance » contemplative dans les films de Haneke. S'il y a bien une chose insupportable au cinéma, c'est cette débauche d'effets pour aspirer le spectateur et l'entraîner sur un mode frénétique d'effets visuels superflus et attractifs, ciblant ainsi une nouvelle génération formatée par la télévision. Comment voulez-vous critiquer quoi que ce soit avec un tel manque de recul ? Tout le film d'ailleurs est fait sur ce mode consumériste en pleine contradiction avec sa soi-disant critique de la société de consommation. Passons sur ce défaut qui condamnerait irrémédiablement le film et arrêtons-nous plutôt sur sa problématique, plus manipulatrice.
Que nous raconte finalement Fight Club ? Il tente de nous parler d'ennui, d'exploitation du désir humain, de rébellion etc. Il y a d'un côté le narrateur qui est Monsieur-tout-le-monde (ou Monsieur-Personne à la fois). Il est anonyme. Cet homme en un mot comme en cent s'ennuie, dépérit. Il ne croit plus en lui-même ; il lui faut des excitants et il en trouve un au début en allant dans les associations où il se repaît du malheur d'autrui. De l'autre, il y a Tyler Durden (Brad Pitt au jeu insupportable et ne possédant que deux-trois grimaces) qui est le tentateur, l'homme de la révolte, le parfait médiateur pour sortir de l'ennui. Il propose un monde « meilleur », et ce monde meilleur passe évidemment par la destruction du précédent. Le projet Chaos n'est rien d'autre que l'apocalypse, autrement dit, le règne du Diable sur la terre. Il n'est pas inutile de rappeler au passage que le diable dans l'ancien testament se nomme Satan et que Satan veut dire : l'adversaire. Satan est le produit d'une révolte. Rôle qui convient remarquablement à Tyler Durden. Au début de la vie, les anges (du grec angelos = messager), créés avant les hommes et dirigés par l'archange Michel, étaient des intermédiaires entre le ciel et la terre. Ces anges se sont divisés en deux, les bons qui sont restés fidèles à Dieu et les autres, les démons (du grec daimones), qui sont entrés en rébellion, suivant leur maître Lucifer (celui qui porte la lumière) qui est devenu « mauvais ». D'eux vient le Diable (en latin diabolus) ou Malin (malignus : méchant.) Si le Diable a été crée par Dieu, ce dernier est « innocent », car le diable s'est détourné de lui et a inventé le péché pour tromper les hommes.
Bref, les deux hommes, le narrateur et Tyler Durden, sont faits pour se rencontrer et s'entendre. Ils fondent le Fight Club qui apparaît comme un groupe fascisant ; comme tout groupe organisé et même toute foule plus généralement, il désigne un bouc émissaire, ici la société de consommation. La solitude crée la tentation. Quand on s'ennuie, on n'existe pas. Peut-on encore exister pourrait-on dire ? Non, vivre seulement, s'enfermer dans le cycle biologique. Comment échapper à ce contrat social ? Par le contrat social renforcé ! La solitude est remplacée par la massification ; contre l'individualisme, il y a le regroupement en un corps constitué, ici le Fight Club. Ceux qu'on appelle les "faibles", les Messieurs-tout-le-monde, semblables les uns aux autres, copies des uns des autres, se révoltent et deviennent de véritables petits tyrans. La lutte entre les deux hommes est une lutte à mort. La douleur semble prouvée à nos yeux que l'on est en quelque sorte vivant ou qu'on existe. La souffrance est la grande école de l'egocentrisme.
Le film pose donc un faux dilemme qui est que, d'un côté, la société de consommation aliène, et de l'autre, que la seule alternative proposée à cette aliénation est la révolte collective. Dans cette problématique, en passant, il est tout de même étonnant que le film ne prenne aucune autres voies et que seule cette extrémité, la destruction de la société (de consommation mais est-ce si sûr ?), nous soit proposée comme allant de soi. Le film de cette manière cloisonne les échappatoires car cette rébellion et la société de consommation marchent au fond main dans la main, l'une n'allant pas sans l'autre, toutes les deux enfermées dans l'animalité, la Vie, donc un oubli de l'Existence (qui n'est pas la vie, le cycle biologique). Quand on veut détruire radicalement quelque chose, quand on est possédé par une telle haine, c'est qu'on ne veut pas s'avouer une admiration cachée. La déresponsabilisation de l'humain vient quand le mal est considéré comme n'étant plus le fait du sujet, mais émanant de la société. Ce qui implique qu'il n'est pas en nous, mais nous est extérieur, étranger. Ce pourquoi on prend un bouc émissaire précisément. Au fond, les révoltés obsessionnels, fruit de leur ennui et de leur frustration, envient un illusoire contentement que leur procurerait la dite société de consommation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas opposés aux buts de cette même société mais sont jaloux qu'elle ne parvienne tout simplement pas à les combler. Ce n'est que du Même s'opposant à du Même, tous les deux enfermés dans la sphère vitale et animale. La phrase de Kafka "Une des plus sérieuses invitations du diable est l'invitation à combattre." prend alors tout son sens.
Historiquement, le problème repose aussi sur un mensonge social. Karl Marx n'avait pas vu qu'émanciper l'homme du travail n'émanciperait pas l'homme de la nécessité et donc de la consommation, c'est-à-dire du métabolisme naturel, condition de la vie même. À l'inverse, cela la renforce. Cette utopie tout en étant le moteur de tous les mouvements révolutionnaires ouvriers d'inspiration marxiste est bel et bien « l'opium du peuple » qui n'est pas seulement l'apanage de la religion. Cette émancipation renforce le processus de consommation qui est si destructeur qu'il remet en cause notre durabilité dans le monde notamment en accélérant la cadence d'usure des produits, c'est-à-dire l'écart entre l'usage et la consommation. Et c'est ce à quoi nous assistons de nos jours. Comme le dit Hannah Arendt : « Avec le besoin que nous avons de remplacer de plus en plus vite les choses de-ce-monde qui nous entourent, nous ne pouvons plus nous permettre de les utiliser, de respecter et de préserver leur inhérente durabilité ; il nous faut consommer, dévorer, pour ainsi dire, nos maisons, nos meubles, nos voitures comme s'il s'agissait des « bonnes choses » de la nature qui se gâtent sans profit à moins d'entrer rapidement dans le cycle incessant du métabolisme humain. #1» Ce qui fait que tous les objets du monde sont devenus des produits du travail dont le sort est d'être consommés, au lieu d'être des produits de l'oeuvre, destinés à servir. Tout ceci a été rendu possible en faisant de l'homme contemporain son propre Dieu après avoir proclamé que le véritable Dieu était mort. Plus rien ne va l'arrêter dans cette perversion avec le principe Mon désir fait Loi. L'homme, à l'égal du hamster faisant tourner une roue dans sa petite cage, tourne sans cesse à l'intérieur de celle de son moi et de ses sensations, bref de la Vie animale. Ce subjectivisme via le sensationnalisme et le sensualisme le plus plat, est le véhicule idéal de la société de consommation qui tient à enfermer les individus dans un banal processus vital qui fonctionne tout seul. Ce qu'on appelle néo-libéralisme peut ainsi faire tourner le cycle biologique comme la roue de la fortune. Transformer l'être humain en homo économicus, gouverné par son seul égoïsme et ses intérêts, fut toujours le but du capitalisme (vieux projet aussi d'un homme-machine )#2 que d'administrer et de plier à ses lois la totalité des intérêts humains en un Marché auto-régulé et mondialisé, ce pourquoi «Vivre sans temps mort et jouir sans entraves » est un slogan libertaire qui ne peut que s'adjoindre à l'économie libérale.
Il n'est donc pas étonnant que le film ne parle nullement des relations familiales par exemple étant donné que les individus sont totalement atomisés. Dans l'économie libérale actuelle, les structures familiales ne sont plus un refuge mais simplement une serre dans laquelle les individus sont élevés selon des directives marketing précises et destinées à les préparer dans le monde nouveau qui advient. Comme le dit Dany Robert Dufour : « Ce que le néo-libéralisme veut, c'est un sujet désymbolisé, qui ne soit plus ni sujet à la culpabilité, ni susceptible de constamment jouer d'un libre arbitre critique. Il veut un sujet flottant, délesté de toute attache symbolique ; il tend à la mise en place d'un sujet unisexe et « inengendré », c'est-à-dire désarrimé de son fondement dans le seul réel, celui de la différence sexuelle et de la différence générationnelle. (...) Le néo-libéralisme est en train de réaliser le vieux rêve du capitalisme. Non seulement il repousse le territoire de la marchandise aux limites du monde (ce qui est en cours sous le nom de mondialisation), où tout est devenu marchandisable (l'eau, le génome, l'air, les espèces vivantes, la santé, les organes, les musées nationaux, les enfants...). Mais il est en train de récupérer les vieilles affaires privées, laissées jusqu'alors à la disposition de chacun (subjectivation, personnaison, sexuation...) pour les faire rentrer dans l'orbite de la marchandise. #3» La société tout entière s'est substituée à la famille en tant que nouveau processus vital et libéral.
Il faut ajouter que cette désymbolisation de l'homme contemporain, la volonté de le sortir de sa condition ancestrale, son passage d'un monde névrotique à un monde pervers où l'exhibition règne en loi, la licence en dévotion, et la transgression en moulin à prières, n'est pas subie mais désirée. Il s'agit bel et bien d'une nouvelle envie de soumission. Notre monde ne pourra pas résister à la terreur sucrée qui va déferler sur lui, au tourisme de masse avec troupeaux d'oies en bermuda, à l'indifférenciation sexuelle, aux mariages gays, à l'homoparentalité, aux oeuvres de divertissement et de diversion, aux films pornographiques, aux jeux vidéo anti-culpabilisateurs, artistes certifiés caritatifs ou aux nouveaux artistes anthropophages autoproclamés (le chinois Zhu Yu qui s'est filmé avec sa vidéo en train de dévorer un bébé mort-né), aux cadavres plastinés, aux clones égalitaires. Et tout ça, en masse, le loisir entre les dents. Nous devenons en fait tous des Raphaël de Valentin, le héros du roman de Balzac La Peau de chagrin, qui est dévoré par son envie de consommer. Se pose alors le délicat problème des loisirs (règne du plaisir intégral, de la vacuité et de l'irresponsabilité) car le temps gagné sur la réduction du temps de travail ne provoque pas un abaissement de la consommation mais étend celle-ci à tous les stades de la société où aucun objet du monde ne sera à l'abri de la consommation, de l'anéantissement par la consommation. Comme par exemple la vie privée, le secret, le sexe, l'art etc. qui, rendus publics, indifférenciés, consommés et massifiés par cette volonté de surveillance, d'exhibition, d'égalitarisme forcené, mourront de leur lente mort. Loisir dans lequel bien évidemment rentre des films comme Fight Club qui prétendent traiter un sujet mais au fond l'évacue, le kitschifie pour le rendre consommable et divertissant.
Fight Club est, en fait, un film "malin" dans l'air de son temps. Au lieu de désillusionner (le sujet du film tout bonnement), il entretient l'illusion tout en prétendant la dissiper. David Fincher n'est bien évidemment pas Michael Haneke. Ceux qui pensent avec raison que l'art (la littérature, la peinture etc.) est la copie vraie de la réalité, dans le sens où il la montre telle qu'elle est ou en restitue la vérité tragique, David Fincher, lui, renvoit la fiction (le film lui-même) a un pur produit irréel, désincarné, n'ayant pas grand chose d'autre à faire qu'à divertir. À mentir donc. Pourquoi ? Rappelons-nous que Tyler Durden était projectionniste et il insérait de courtes images de phallus dans les films qu'il projetait. Évidemment, Fight-Club ne parle pas de cela par hasard car dans le film même sont insérés ces mêmes images, au début et à la toute fin (en passant le film au ralenti, on aperçoit effectivement un sexe en érection) pour bien rappeler que nous sommes dans un film, c'est-à-dire dans quelque chose de factice. À un moment, l'image sort même de son cadre. David Fincher joue donc souvent sur la notion de projection et sur la nature illusoire et factice du support cinématographique avec une mise à jour physique de l'artifice. Nous allons voir ce que cet aspect du film n'a pas été posé au hasard.
Qu'apprenons-nous à un moment du film ? Tout bonnement que Tyler Durden n'est qu'autre que le narrateur lui-même ! Fort de cette surprenante nouvelle, le narrateur tente par tous les moyens d'enrayer les explosifs que sa part maudite a disséminés dans plusieurs immeubles bancaires (évidemment à Hollywood, c'est toujours à la dernière minute). Rien n'y fait. Le Fight Club est tellement bien infiltré dans la société qu'il a même des adeptes dans la police ! Finalement, le narrateur se retrouvera prisonnier de son double... Donc de lui-même ! Et comment se débarrasse-t-il de son double ? En se tirant une balle dans la bouche, balle qui ressort par la joue. La scène est énorme. Tout d'abord, elle est grotesque parce qu'on ne peut pas physiquement éliminer son double (un profond trouble psychique tout de même) en se tirant simplement une balle dans la bouche (il aurait mieux valu carrément viser la tête). Si le narrateur voulait tuer physiquement son double, il aurait dû se tuer lui-même. Sur ce point, c'est Edgar Poe qui vient à notre secours avec sa remarquable nouvelle, William Wilson, où un individu est persécuté par lui-même. Son double le copie et le dénonce au jeu. Et quand William Wilson décide de se battre avec son double, il pense s'en débarrasser en le tuant mais il se rend compte, trop tard, qu'il vient de se tuer lui-même. Ce qu'Edgar Poe avait compris, David Fincher ne le comprend pas ou l'ignore.
Cette profonde incohérence du film n'est pas seulement narrative mais ontologique. Comme si le mal (ou le diable) n'était pas véritablement en nous mais extérieur à nous (même s'il est notre double, donc le même personnage !) et qu'on peut le tuer d'un simple coup de revolver. Car la projection du narrateur n'existe que dans la tête du narrateur et Tyler Durden n'existe tout simplement pas. Seul le film fait croire fantasmatiquement à cette incarnation du double extérieur à soi dans la réalité. D'autre part, le film accrédite que l'on peut tuer son double monstrueux pour retrouver la bonne part de soi-même et sur ce point, Fight-Club est aussi mensonger en faisant croire au spectateur qu'on peut projeter son mal en un double et surtout un double qu'on peut tuer avec un pistolet. Cependant, d'un autre côté, jouant sur tous les tableaux, le film est plus pervers que cela. Je pense qu'il établit consciemment cette incohérence pour décrédibiliser ce qui se passe sur l'écran même. Au fur et à mesure que Fight Club avance, nous quittons le terrain de la prétendue autopsie de la société de consommation, le terrain du réel, pour partir dans l'extravagant, l'irréalité, le grotesque, l'invraisemblable. Le film joue sur la projection d'un double et retourne le processus dans le mécanisme cinématographique lui-même. Voyons tout cela n'est qu'une illusion ! Alors quoi ? Le film prétend dénoncer quelque chose et tout ne serait qu'illusion ? Pourquoi faire un film alors ? Le film se clôt et implose lui-même. Finir par une telle pirouette, c'est retirer au film même la critique de la réalité qu'il prétendait installer chez le spectateur. Donnons du spectacle au spectateur en lui faisant croire qu'il est un rebelle. Le sujet ici, la déshumanisation, la société aliénant l'individu contemporain, se voit peu à peu littéralement vampirisé par la mise en scène et la narration du film. Cependant, Fight Club a bien un message à faire passer : un film n'est qu'un objet gentil et à travers cet objet, ce qui est visé c'est la fiction elle-même qui ne peut prétendre à rien, pas même à une portée critique sur le monde qui nous entoure. On ne peut pas mieux déréaliser le réel et réduire à néant toute tentative de comprendre quoi que ce soit. Le film ne joue des codes que pour jouer des codes, non pas pour dire des choses concrètes sur la réalité avec ces mêmes codes, mais pour jouer des codes gratuitement et faire passer du temps. Fincher n'est qu'un des fossoyeurs du cinéma parmi d'autres : retirer au cinéma ou à un art sa potentialité de dire des choses sur la réalité. C'est même évident dans un tel système économique où le film prend naissance que de s'appuyer sur des tendances de la société permettant au film de faire des entrées : la révolte ou la rébellion comme tendance contraire à la société de consommation alors qu'elle en est l'instigatrice ou le double inversé. Il n'est pas donc pas très étonnant que le film de David Fincher ait trouvé un large écho sur les jeunes rebelles d'aujourd'hui (avec dans le même genre le grotesque et post-moderne Requiem for a dream de Daniel Aronosky).
Fight Club n'est au fond qu'un banal et simple produit de consommation. Il invite à consommer du film, des stars et se termine sur un « feu d'artifice », en fait, un pétard mouillé. Étrange pétard mouillé d'ailleurs. Le narrateur ne prend-il pas la main de sa compagne pour contempler des explosions d'immeubles ? Rappelons-nous ce que montre la fin de Fight Club : le narrateur a donc tué son double, et après s'être tiré une balle dans la bouche, il prend benoîtement, et sans avoir trop mal (ce qui renforce l'irréalisme de la scène), la main de sa petite amie, et lui dit : Marla, regarde-moi. Je vais vraiment bien. Crois-moi, tout ira bien désormais. Tu m'as rencontré à un moment très étrange de ma vie.» et ils regardent les immeubles qui explosent. Tout d'abord, le narrateur semble avoir oublié que c'est pourtant son double destructeur qui fait sauter les immeubles. Il devrait donc être effrayé. Nullement. Prendre la main de sa petite amie est révélateur d'une jouissance devant un tel spectacle alors que ce spectacle provient de sa propre tendance destructrice en apparence détestée. Sans compter que détruire même des immeubles vides ne va pas aller sans dégâts comme le 11 septembre 2001 nous l'a montré. Maintenant que l'on a en tête les images des twins towers s'écroulant, on ne peut pas imaginer qu'une dizaine d'immeubles (même vides, variante risible du terrorisme philanthropique !) se fassent sans victimes ou ne fassent que des dégâts matériels.
Peu importe finalement car de telles images de destruction sont tout de même révélatrices en soi. Plus profondément, il est intéressant de remarquer qu'à ce moment-là, le film jouxte simultanément jouissance amoureuse et jouissance d'anéantissement. Je ne doute pas d'ailleurs une seule seconde que le spectateur ressente justement une grande jouissance à ce « spectacle ». Car ici la suprême jouissance n'est pas dans l'acte sexuel proprement dit mais dans l'anéantissement. Ce qui ne nous étonnera nullement car, souvenons-nous, non seulement le narrateur dans son ennui voulait qu'il lui arrive un accident d'avion mais la douleur et le combat étaient véhiculés comme signe de vie. En voilà l'accomplissement total et final. L'idée est non seulement perverse au sens clinique du terme mais très révélatrice du monde contemporain qui veut sa propre destruction dans sa logique ultra-consumériste, dans son désir de visibilité intégrale, d'exhibition de son ego (web-cam etc.), conséquences où la totalité du monde est lentement grignotée et mâchée par l'esprit de consommation. Le film se termine ainsi sur une image subliminale, l'image d'un phallus en érection (encore une image érotique exhibée et associée à la destruction, et faussement subliminale de surcroît), afin de bien rejeter ce qui est montré dans la sphère du spectacle et du divertissement, histoire que le spectateur ne prenne pas pour argent comptant ce qui lui est montré.
Que reste-t-il en fin de compte de la critique de la société de consommation ? Plus rien. La fiction se retrouve déposséder de tout statut concret sur ce qu'elle peut dire sur le réel. La fiction n'est qu'illusion, produit et non œuvre ; elle ne dit rien au fond de concret sur le réel, sur le désir humain. Le film coupe tout lien concret entre fiction et réel pour n'en faire qu'un produit de consommation destiné à être consommé, ingurgité, vidé de toute substance. Comme le film joue sur tous les tableaux pour toucher tous les publics et se rentabiliser au maximum, il prend en compte les tendances destructrices de la société en prétendant les interroger. L'impact est double : toute fiction est vaine et toute action dans la réalité, ou pour comprendre le réel est tout aussi vaine. Finalement : consommez ! C'est justement la perversion d'un tel film comme Fight Club, d'être un loisir, un film de divertissement singeant la critique de la société de consommation pour en fait un loisir de plus. Nous voici dans le processus destructeur de la consommation. Cette industrie de l'entertainment comme l'a décrit Hannah Arendt, entretient l'autosatisfaction, glorifie le plaisir et le divertissement comme seule fin de l'art. Ce qui équivaut à sa mort, à un désir de sa mort.
Le problème est que Fight Club devient une référence esthétique pour une certaine génération gavée de jeux vidéos, de télévision et d'internet alors que le film prend les allures de la contestation, façon d'évacuer les véritables enjeux qu'un tel sujet recèle. Mis en comparaison avec d'autres films traitant le même sujet (et il faut les comparer dans la facture, la mise en scène etc. pour voir les supercheries de l'un et la valeur des autres), Fight Club ne résisterait pas deux secondes et se retrouverait instantanément dévalué comme banal produit de l'usine à rêves qu'est Hollywood. Le seul intérêt n'est donc pas dans sa valeur esthétique mais dans la perversion, le rêve de mort et le désir d'anéantissement que la société de consommation révèle malgré elle.